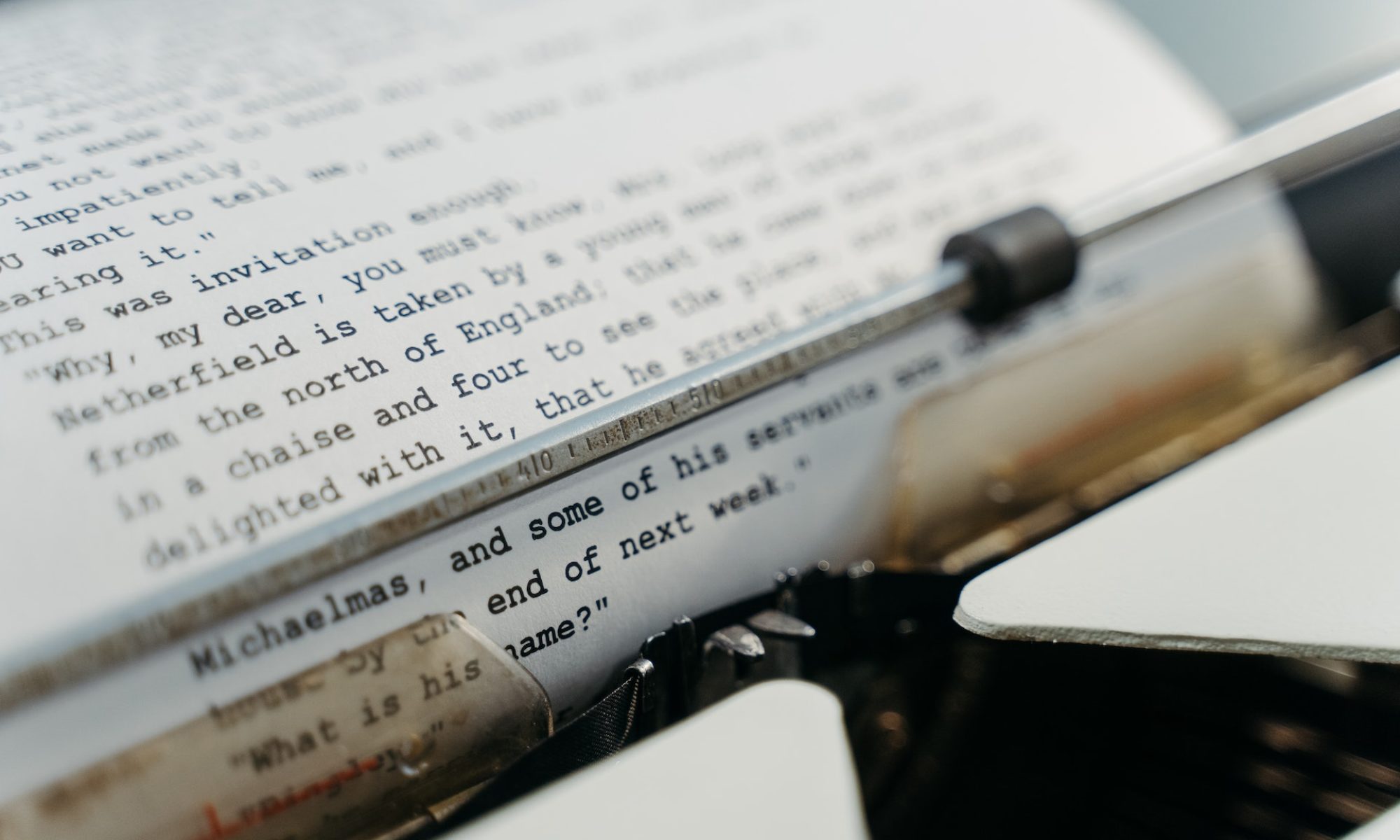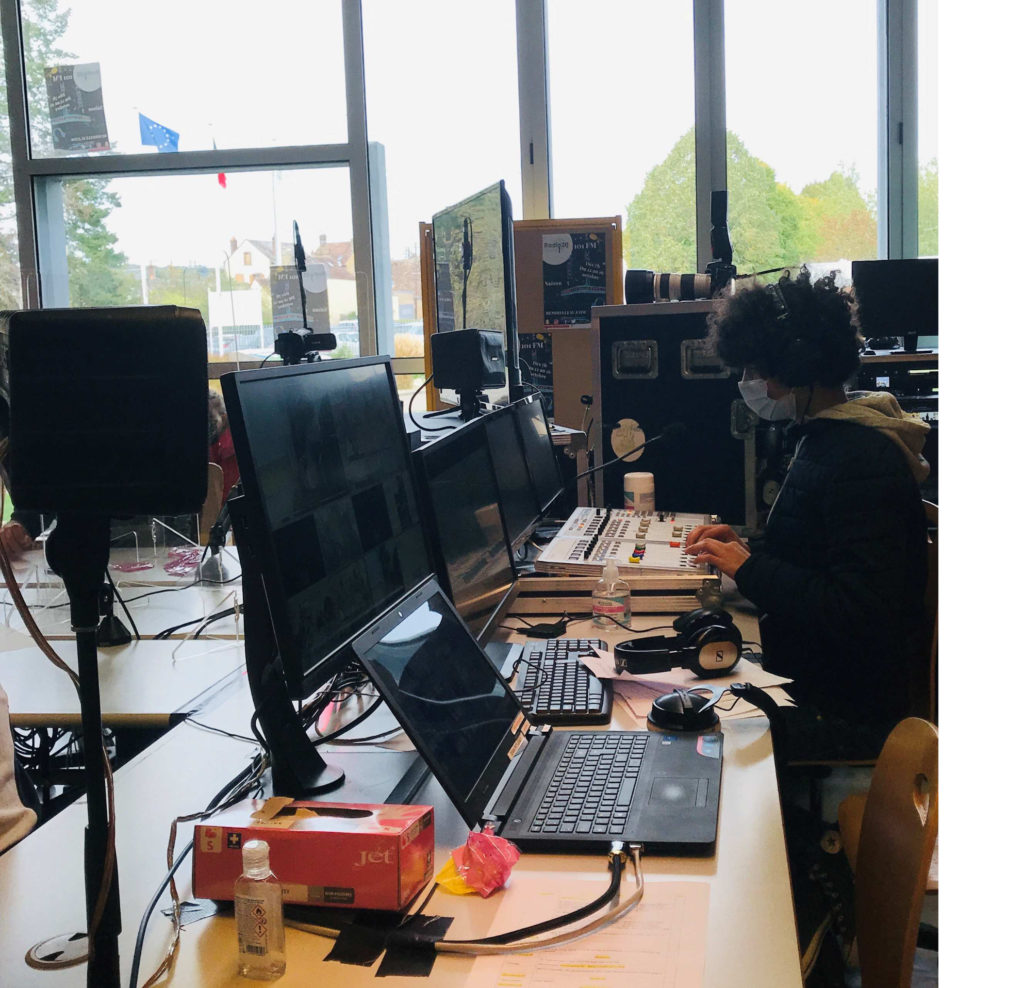Depuis les années 1970, les débats sur les discriminations font rage. Aujourd’hui, une société nouvelle émerge n’acceptant plus la discrimination et luttant contre toute forme de racisme, de sexisme et contre les stéréotypes et les préjugés qui en sont à l’origine. Dans cet article, nous allons essayer de dresser un bilan des discriminations en France, d’expliquer leurs mécanismes et de poser la question de leur présence dans le milieu scolaire.
Un phénomène généralisé mais en recul
Pour rappel, une discrimination est le fait de traiter un groupe de personnes différemment des autres et d’une manière défavorable. Elle peut être en raison de différences physiques telles que la couleur de peau, le sexe, l’âge ou le handicap mais aussi en raison d’une appartenance religieuse ou ethnique ou de l’orientation sexuelle. La loi française recense 25 critères rentrant dans la définition de discrimination mais certaines études l’ont même démontré selon des critères de poids et de beauté. Le phénomène de discrimination est donc bien plus généralisé dans notre société que ce qu’on pourrait penser car il touche en fin de compte une large majorité de la population. Pourtant de nombreuses personnes ne se pensent absolument pas concernées par cette question. Ce problème semblerait alors en augmentation mais il n’en est rien. Il suffit de voir la condition féminine ou le racisme dans les années 1960 pour se rendre compte que la situation s’est largement améliorée mais notre société, devenant plus égalitaire, est désormais bien plus attentive à ce phénomène.
Discriminations directes et indirectes
La loi française sanctionne lourdement la discrimination quand il s’agit de discrimination directe dans une situation précise telle que l’accès à un service, à un logement ou à un travail et que celle-ci est démontrée. Par exemple, elle peut être punie de 3 ans de prison ferme et de 45 000 euros d’amende pour discrimination à l’embauche mais celle-ci est très difficile à prouver. En France, c’’est le Défenseur des Droits qui a la mission de recevoir ces plaintes. Mais pour mesurer l’effet dévastateur de ces discriminations sur un groupe social dans son intégralité, les études sur les discriminations indirectes ou structurelles sont les plus instructives. On appelle discrimination indirecte les désavantages d’un individu ou d’un groupe d’individus par rapport à un autre. Ce sont elles qui ont permis de dresser ces constats alarmants. A travail égal, une femme touche un salaire 20% plus faible que celui d’un homme ou alors, hasard des chiffres, une personne supposée d’origine maghrébine a 20% de chance en moins d’être embauchée.

Escalier du lycée Rémi Belleau créé en mars 2021 pour sensibiliser les élèves à la lutte contre les discriminations
De la discrimination aux actes de violence
Les discriminations se nourrissent toutes de l’intolérance et des préjugés de la société sur certains individus ou groupes sociaux. Poussés à leur extrême, ils entraînent la forme la plus traumatisante de la discrimination; les agressions verbales ou physiques à caractère racial ou en raison de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle. En France, chaque année ce sont plus de 1800 menaces ou actes violents antisémites, islamophobes, ou racistes, et antichrétiens qui ont lieu et ces chiffres ont doublé en moins de trois ans. De même, près de 1800 agressions homophobes et transphobes ont lieu chaque année et ce chiffre augmente de 30 % chaque année depuis plus de deux ans. Ces chiffres démontrent l’intensification de l’intolérance et l’augmentation des actes violents. Tout cela combiné à la haine qui se déverse à travers les réseaux sociaux donne la sensation d’une société de plus en plus discriminante.
Discrimination directe et indirecte en milieu scolaire
Les établissements scolaires représentent tout de même des lieux moins touchés par les discriminations directes grâce à l’affirmation de l’école laïque et par un système égalitaire entre les élèves. Cependant, ils restent dans le même contexte que le reste de la société. Ainsi, les incidents à caractères racistes touchent près de 3% des écoliers chaque année. Des discriminations indirectes sont visibles dans de nombreux établissements avec par exemple une perte de diversité entre la classe de 2nde et de 1ère générale. On peut aussi évoquer des préjugés fréquents au sein des lycées notamment le point de vue négatif de certains élèves de section générale sur les élèves en sections professionnelles et technologiques. Les discriminations touchent donc toutes les sphères de la société et affaiblissent les idéaux d’égalité et de fraternité nécessaires à toute vie en communauté. C’est pourquoi la lutte contre celles-ci constitue un enjeu majeur de notre société et chacun peut et même doit y jouer un rôle.